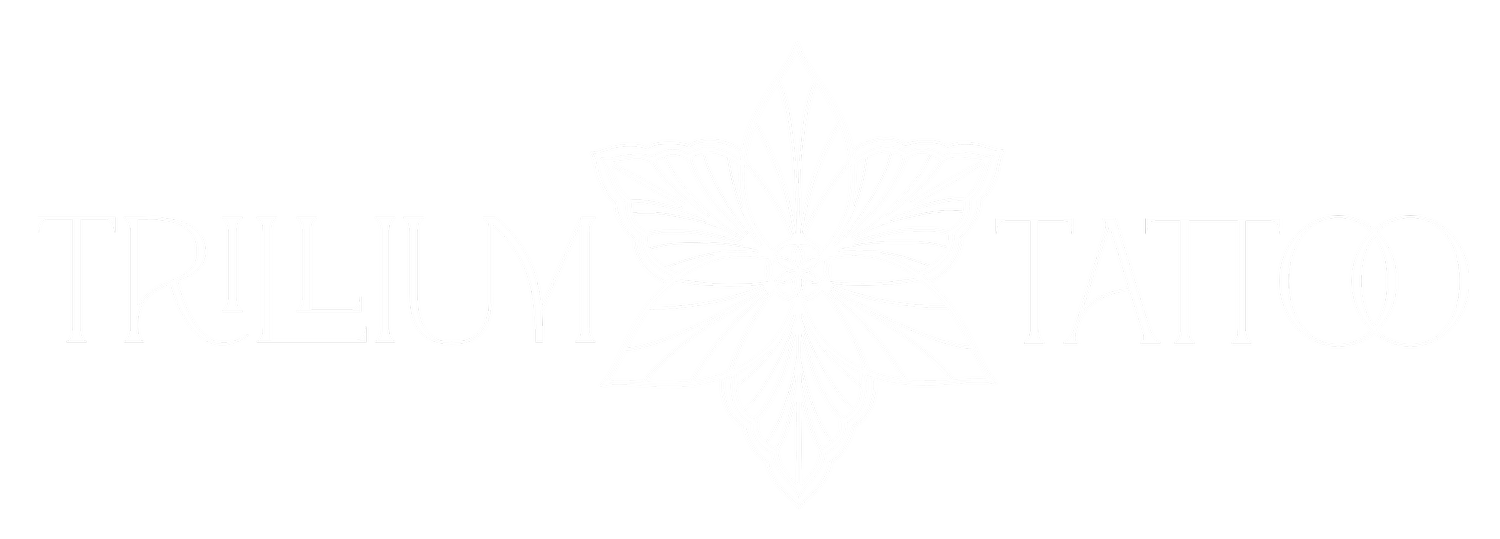Le tatouage et la gestion de la douleur
La fameuse question : « Est-ce que ça fait mal ? »
Lorsqu’on parle de tatouage, arrive souvent la question fatidique :
« Est-ce que cela fait mal ? »
Comme la douleur ne repose pas que sur un ressenti, elle est toujours difficile à qualifier ou à quantifier. C’est pourquoi il m’est toujours difficile de répondre à la question simplement.
Avant de répondre à cette question il faut que je vous explique comment ça se passe au niveau de la peau quand je tatoue.
Ce qui se passe sous la peau
Avec ma machine et la fameuse aiguille, qui est en réalité un faisceau composé de plusieurs petites aiguilles, je mets l’encre dans le derme de la peau. C’est une partie irrégulière, coincée entre l’épiderme et l’hypoderme. Les vaisseaux et nerfs de la peau se situent dans l’hypoderme donc, théoriquement, avec une précision digne d’un chirurgien, le tatouage ne devrait pas être douloureux.
Mais voilà : ces zones de la peau sont irrégulières et la douleur provient du fait que l’aiguille touche par « accident » l’hypoderme.
Il y a aussi l’autre douleur, provoquée lorsqu’on passe au travers l'épiderme avec les aiguilles. Sur le coup, les premières minutes, c’est surtout la nouveauté de la sensation qui fait que le cerveau doit s’habituer. Ce qui prendra environ 15 minutes avec l’aide du cerveau qui envoie un peu d’endorphine. Par contre, après un certain temps, variable pour chaque personne, situation et endroit du tattoo, la peau fait une inflammation pour se protéger, ce qui cause la sensation de brûlure.
Est-ce que ça fait toujours mal ?
Un tatouage fait donc toujours mal, mais :
la douleur, même intense, est objectivement supportable.
c’est la durée du tatouage qui peut rendre les choses compliquées.
l’intensité de la douleur entre les lignes et le remplissage est encore une fois différente d’une personne à l’autre et d’une séance à l’autre.
Certains préfèrent les lignes, d’autres le remplissage.
Parfois cela peut même être presque agréable.
Parfois certain(e)s s’endorment.
Et parfois c’est à la limite du supportable.
Ce qui influence la douleur
Chaque personne est différente et chaque zone du corps est différente.
De plus, plusieurs facteurs entrent en jeu :
l'état de santé
le moral
l'état de fatigue
l'état mental
la capacité psychologique
l'endurance
L’aspect physique
Le tatouage est comparable à :
une écorchure
une piqûre
une griffure
une sensation de brûlure
une égratignure de griffe de chat
Notre corps a tout prévu pour nous aider à traverser les épreuves douloureuses, en sécrétant des endorphines lorsque nous en avons besoin et sur les zones qui en ont besoin.
Les endorphines sont des molécules pareilles à de la morphine, mais d’origine endogène, c’est-à-dire sécrétées par notre propre corps pour nous anesthésier. Notre corps sait les fabriquer lorsque nous nous blessons ou lorsque nous faisons des efforts pénibles (comme des séances intensives de sport). Elles nous aident à traverser l’épreuve avec plus de facilité. Elles ont également un effet euphorisant.
C’est ainsi que :
les quinze premières minutes d’une séance de tatouage peuvent paraître plus ou moins douloureuses
par la suite, sous les effets des endorphines, on s’habitue
après cette phase d’adaptation, et pendant un temps plus ou moins long selon votre condition physique et mentale, le tatouage peut même devenir agréable
Si la séance dure au-delà de nos capacités à produire ces endorphines, la douleur redevient présente.
On dit toujours qu’il faut venir en forme et reposé pour se faire tatouer, justement pour bien vivre la séance. La fatigue rendant toute épreuve ou expérience toujours plus pénible. Pour les dames, il convient également de remarquer que la période des menstruations rend plus réceptive à la douleur. Il est donc important de :
bien manger
bien s’hydrater
bien dormir la veille
Ça ce sont les bases.
L’aspect mental
Au-delà de l’endorphine produite par notre corps, il y a la gestion de la douleur sur le long terme.
Certains peuvent endurer la douleur, même minime, qu’une seule heure et d’autres pendant plus de 8 hrs. Ceci est causé par nos expériences et notre mental.
Par exemple :
une femme qui a accouché d’un enfant sera plus tolérante à la douleur du tattoo, plus longtemps, car elle a une référence de douleur plus élevée
les femmes en général sont plus tolérantes vu qu'elles ont des douleurs chaque mois, ce qui cause des renforcements mentaux pour la gestion de la douleur
un homme qui aurait vécu un accident douloureux avec une longue réhabilitation sera aussi plus tolérant
Ensuite, il y a aussi la gestion mentale de la douleur. C’est le grand secret des personnes qui font de longues séances de tattoo. Je sais par expérience que plus on utilise des techniques de détente avant et pendant la séance, mieux se passe la séance.
La focalisation sur :
la respiration
le calme intérieur
une pensée agréable
un souvenir
une motivation par rapport au tatouage
de la musique
... permet de transformer son ressenti de manière positive.
Les techniques de sophrologie voire d’auto-hypnose sont remarquablement efficaces. Il faut savoir s’abandonner au processus. Le conditionnement mental que vous adopterez fera la différence.
La peur d’avoir mal est normale, j’appréhende toujours avant une séance, mais j’essaie de ne pas me bloquer dessus. Je sais que je vais avoir mal alors je me motive au résultat, au processus, à l'expérience... je me conditionne et j’arrive déterminée !
De nombreuses personnes stressent avant leur séance, même si elles sont impatientes ou heureuses que le jour J soit enfin arrivé. Il est normal d’avoir une forme d’appréhension et de stresser un peu, et même lorsqu’on s’est déjà fait souvent tatouer cela peut arriver.
L’aspect mental est ici d’une grande importance. Il convient de toujours positiver, de ne pas se répéter sans cesse que « cela va faire mal » car ce type de pensées sont de véritables injonctions pour notre subconscient.
Il est préférable de travailler ses pensées intérieures, se créer une ambiance mentale motivante, agréable, forte, reposante… ce n’est pas un sprint !
Imaginez-vous être un marathonien qui a un long parcours à faire avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Comment croyez-vous qu’il arrive à parcourir les 52 km avec la forte chaleur du soleil sur ses muscles endoloris, sa soif, la douleur répétitive de ses pieds qui frappent le béton…?
J’ajouterais qu'il y a dans le processus du tatouage une part initiatique de confrontation avec nous-mêmes et avec notre douleur et notre nature humaine. Il faut reconnaître que se faire tatouer inclut aussi l'acceptation de vivre cette expérience en embrassant la douleur qui l'accompagne. Cela fait partie intégrante du processus !
Notre monde moderne gorgé de confort et de facilité nous a fait oublier cette dimension de difficulté et d’endurance qu’il est nécessaire d’apprivoiser dans la vie. L’art ancestral du tatouage nous permet de retrouver ce chemin de connaissance et de maîtrise de soi.
Les zones du corps
D’une manière générale :
les zones généralement protégées (côtes, flanc du corps, sous bras, entre jambes) et les zones avec beaucoup de terminaisons nerveuses (main, pied, visage, colonne vertébrale, mollet) sont plus douloureuses
les zones “habituées” aux chocs (dessus bras, épaule, dessus cuisse) sont souvent moins sensibles
les zones où la peau est mince au-dessus d’un os (tibia, genou, coude, jointure, sternum…) font plus mal si le tatoueur ne travaille pas avec plus de délicatesse
L’état général de santé de la personne
Le tatouage va créer une réaction d’inflammation cutanée qui est normale.
Cependant, si pour une quelconque raison votre corps ou la zone de votre corps à tatouer est déjà en état inflammatoire, la perception de la douleur sera accrue.
Si votre colonne vertébrale présente :
des zones de faiblesses
des pathologies (tassements, hernies…)
ou si votre dos est rempli de tensions musculo-squelettiques
… vous aurez une sensibilité accrue à la douleur du tatouage.
De même, si une épaule souffre de douleurs articulaires, le tatouage sur cette épaule sera probablement difficile à supporter.
Parfois, c’est même la position statique pour faire le tattoo qui cause de la douleur.
Et les anesthésiants ?
Il n'est pas recommandé de les utiliser pour se faire tatouer :
cela peut modifier la manière dont l'encre adhère à la peau
cela peut provoquer des réactions allergiques
cela ne supprime pas la douleur mais la rend simplement plus supportable temporairement
Demandez à votre tatoueur ses meilleures options si lors d’une séance vous vous sentez moins tolérant(e).
Dans mon cas, j'ai un vaporisateur que j’adore, que je mets juste en fin de session pour finaliser une étape d’un gros projet qui ne peut être interrompu pour continuer la prochaine session.
Pour une meilleure guérison, vaut mieux s’arrêter lorsque le client arrive à sa limite d'endurance.
Le corps du tatoué est une création merveilleuse qui prend tous les moyens pour s'exprimer lorsqu’il n’a plus de ressource pour aller plus loin. Il faut l'écouter.
Un mot pour finir
N’hésitez pas à m’en parler. Votre tatoueur/tatoueuse devrait être ouvert et bienveillant, parlez-lui.
N’oubliez pas qu’il/elle se doit d’aborder la question de la douleur avec chaque client.
En tant que tatoueuse je reste sensible à vous accompagner au mieux dans la gestion de cette douleur, en vous mettant à l'aise, et dans mes gestes plutôt doux.
Si tu es prêt à franchir le pas, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi directement via ce formulaire !
Karine Steinblume
Tatouage : L’histoire gravée sous la peau
Le tatouage, art sacré et intemporel, raconte sur la peau des histoires uniques. Des motifs spirituels polynésiens aux Irezumi japonais, chaque encre incarne identité, protection ou rébellion. Un langage universel qui traverse les âges et les cultures.
Un trait d’encre sur la peau, une histoire qui se dessine à jamais. Depuis la nuit des temps, l’homme grave son identité sur son corps, à coups d’aiguilles, de pigments et de symboles. Rite sacré, marqueur social, acte de rébellion ou chef-d'œuvre artistique, le tatouage traverse les époques, indélébile et fascinant. Mais d’où vient cette obsession millénaire pour l’encre sous-cutanée ? Plongeons ensemble dans l’histoire mouvementée du tatouage.
Des origines qui remontent à la Préhistoire…
Imaginez un homme il y a plus de 5 000 ans, marchant dans les montagnes glacées des Alpes. Son nom ? Ötzi. Enfin… c’est ainsi qu’on l’a baptisé lorsqu’on a retrouvé son corps momifié en 1991. Sur sa peau, 61 tatouages. Des traits sombres, réalisés à l’aide de suie et de charbon, alignés le long de sa colonne vertébrale et de ses articulations. Thérapie primitive contre les douleurs ? Rituel spirituel ? Mystère. Une chose est sûre : l’encre sous la peau est plus ancienne que l’écriture.
Et Ötzi n’est pas un cas isolé. Des momies tatouées ont été découvertes en Sibérie, en Chine, en Égypte. Partout dans le monde, des peuples ont adopté cette pratique, gravant leur histoire directement dans leur chair.
Égypte, Grèce, Rome : tatouage entre sacré et infamie
Dans l’Égypte antique, les tatouages étaient surtout réservés aux prêtresses et aux danseuses. Leur rôle ? Sans doute mystique, protecteur, voire thérapeutique. Certains symboles auraient été liés à la fertilité et à la maternité.
Les Grecs et les Romains, eux, avaient une tout autre vision du tatouage. Ici, pas de spiritualité : l’encre servait à marquer les esclaves, les criminels et les prisonniers. Une cicatrice sociale qui vous suivait partout, impossible à effacer. C’est d’ailleurs de là que vient le mot "stigmate", aujourd’hui synonyme de marque indélébile.
Asie et Polynésie : le tatouage, une identité sacrée
Pendant que l’Europe diabolisait l’encre sous la peau, d’autres cultures en faisaient un art sacré.
Au Japon : l'irezumi, entre art et criminalité
D’abord utilisé comme punition, le tatouage japonais a fini par devenir un véritable art, avec des motifs spectaculaires couvrant le dos, les bras, voire le corps entier. Mais avec l’émergence des Yakuza, les célèbres gangsters japonais, l’irezumi est devenu synonyme de criminalité. Résultat ? Encore aujourd’hui, au Japon, de nombreux établissements interdisent l’entrée aux personnes tatouées.
En Polynésie : l’encre comme récit de vie
C’est en Polynésie que le tatouage a pris une dimension des plus profondes. Ici, chaque motif raconte une histoire : origine, rang social, exploits personnels. Plus un homme était tatoué, plus il était respecté. D’ailleurs, le mot "tatouage" vient du tahitien tatau, qui signifie "frapper" ou "marquer".
Moyen Âge et Renaissance : quand l’encre devient hérétique
Avec la montée du christianisme, l’Europe bannit le tatouage. Marquer son corps, c’est souiller l’œuvre de Dieu.Résultat ? Il disparaît presque totalement du Vieux Continent.
Seuls les marins et les pèlerins chrétiens continuent à se tatouer, parfois en revenant de Terre Sainte. Mais globalement, l’encre devient un tabou, un signe d’hérésie ou de criminalité.
Le XIXe siècle : le grand retour du tatouage en Occident
Tout change avec l’ère des grands explorateurs. Lors de leurs voyages en Polynésie et en Asie, les marins occidentaux découvrent des tatouages fascinants… et en ramènent sur leur propre peau. L’ancre marine, la rose des vents, la sirène… autant de motifs qui symbolisent leurs aventures en mer.
Mais ce n’est pas tout : les aristocrates aussi succombent à cette mode. Le roi Édouard VII d’Angleterre et le tsar Nicolas II de Russie se font tatouer. Une manière, pour eux, d’afficher leur goût pour l’exotisme et l’aventure.
En 1891, Samuel O’Reilly invente la machine à tatouer électrique. Finie l’époque où il fallait insérer l’encre sous la peau à l’aide d’épines ou de marteaux ! Le tatouage devient plus rapide, plus précis, plus accessible.
XXe siècle : de la rébellion à la reconnaissance
Longtemps réservé aux marins, militaires, détenus et rebelles, le tatouage entre peu à peu dans la culture populaire. Dans les années 1950-60, il devient un symbole de rébellion : rockeurs, bikers, punks… Tous adoptent l’encre comme un signe de marginalité et de défiance envers l’ordre établi.
Mais les années 1990 et 2000 changent la donne : le tatouage devient un véritable phénomène de mode. Des célébrités l’arborent fièrement, des tatoueurs de renom émergent et l’art du tatouage atteint un niveau artistique jamais vu auparavant.
Aujourd’hui, qu’il soit minimaliste, hyperréaliste, tribal, old school ou aquarelle, il n’y a plus de limites.
Le tatouage aujourd’hui : un art à part entière
Il y a encore quelques décennies, les tatoués étaient perçus comme des marginaux. Aujourd’hui, tout le monde (ou presque) porte fièrement un morceau d’encre sous la peau. Le tatouage est devenu un moyen d’expression puissant, un art unique qui s’ancre à même le corps.
Mais au fond, quelle que soit l’époque, le principe reste le même : chaque tatouage raconte une histoire.
Et vous, quelle est la vôtre ?